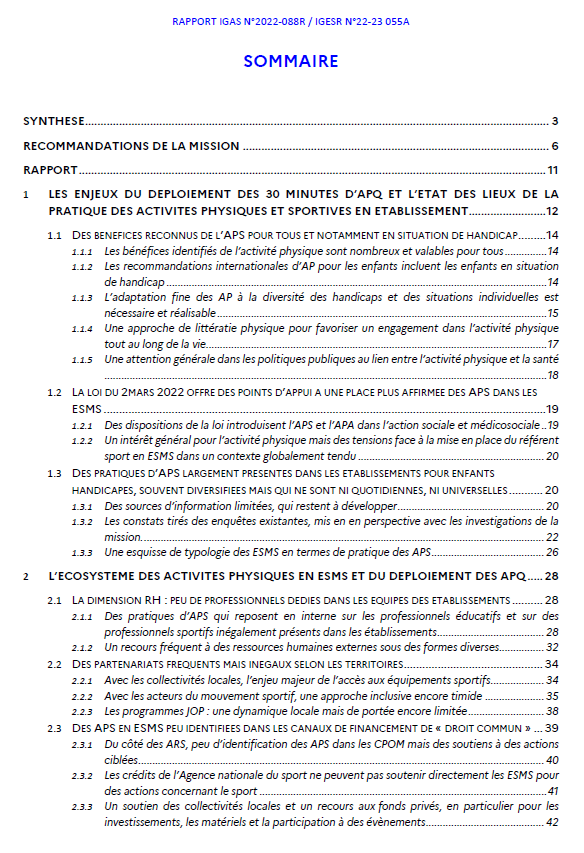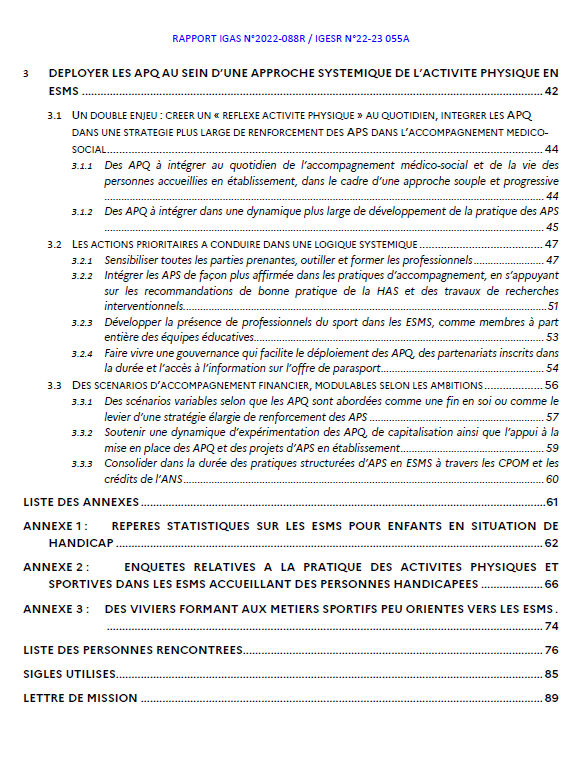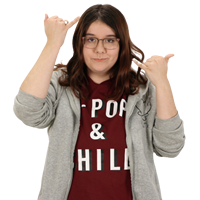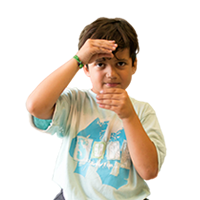Sport et handicap

Notions
Trois notions doivent être distinguées :
– L’activité physique ;
– L’activité sportive ;
– L’activité physique adaptée (APA).
Ces notions ne poursuivent pas toujours des objectifs similaires et sont mises en œuvre selon des modalités différentes. L’activité physique est définie par l’OMS comme « tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d’énergie »12 supérieure à celle dépensée au repos. Elle se distingue de l’activité sportive en ce qu’elle ne nécessite pas d’infrastructures lourdes ou d’équipements spécifiques et ne répond pas à des règles de jeu. Il peut s’agir tout simplement de tâches de la vie quotidienne telles que le jardinage, se déplacer à vélo ou à pied, mais également d’activités comme le footing ou une séance de renforcement musculaire.
L’activité sportive correspond à une activité physique régie par des règles, pouvant être soit individuelle, soit collective.
L’activité physique adaptée renvoie à une notion encadrée par le Code de la santé publique (CSP). L’article D. 1172-1 du CSP la définit comme « la pratique dans un contexte d’activités du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires ». Les activités physiques adaptées peuvent notamment être dispensées dans des conditions prévues par décret (Décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l’activité physique adaptée) et sont destinées à prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies, à augmenter l’autonomie et la qualité de vie des patients, voire à les réinsérer dans des activités sociales.
Stratégie Nationale Sport et Handicaps
La Stratégie Nationale Sport et Handicaps du ministère chargé des Sports a été présentée le 3 décembre 2020.
https://www.sports.gouv.fr/strategie-nationale-sport-et-handicaps-2166
Table des matières


Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024
https://www.sports.gouv.fr/media/2182/download
https://www.sports.gouv.fr/strategie-nationale-sport-sante-2019-2024-85
Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2024/5 du 15 mars 2024
Note d’information interministérielle N° DGCS/SD3A/SD3B/DS1A/2024/21 du 29 février 2024 relative au déploiement de l’activité physique et sportive dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) du champ de l’autonomie
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2024/2024.5.sante.pdf
Instruction interministérielle N° DGCS/SD3A/SD3B/DS1A/2024/20 du 29 février 2024 relative aux missions des référents en agences régionales de santé (ARS) et en délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES) pour le développement de l’activité physique et sportive des personnes âgées et en situation de handicap en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)
Ressources
Le HandiGuide des sports : https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
Mon parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
Fédération française handisport : https://www.handisport.org/
Comité paralympique et sportif français : https://france-paralympique.fr/
Rapport IGAS N°2022-088R / IGESR N°22-23 055A
Gueydan G., Grafto M., Kallenbach S., Mise en œuvre de 30 minutes d’activités physiques quotidiennes dans les établissements pour enfants en situation de handicap, IGAS n°2022-088R / IGESR n°22-23 055A, 90p., Paris, avril 2023.
Activités physiques quotidiennes
Les gouvernements successifs ont œuvré pour promouvoir l’activité physique et sportive pour tous. À ce titre, le dispositif des activités physiques quotidiennes (APQ) a été introduit dans les écoles, initialement sur une base de volontariat à la rentrée 2021-22 puis de manière généralisée à la rentrée 2022-23. Cette généralisation répond à la loi de démocratisation du sport du 2 mars 2022 qui garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires en plus du programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive par la création de l’article L 321-3-1 du code de l’éducation.
Le conseil olympique et paralympique du 25 juillet 2022 à l’Élysée a acté l’élargissement du dispositif des 30 minutes d’activités physique quotidiennes aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), décision à décliner en premier lieu dans les établissements accueillant des enfants en situation de handicap, dans une logique d’égal accès de tous les enfants à une activité physique quotidienne, y compris pour ceux non scolarisés en milieu ordinaire. Le public ciblé concerne la tranche d’âge des jeunes accueillis en ESMS, soit de trois ans à 21 ans.
L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et l’inspection générale des affaires sociales ont été saisies, par un courrier en date 3 octobre 2022 co-signée des ministres chargés des sports et des personnes handicapées, d’une mission relative à l’élargissement du dispositif des 30 minutes d’activité physique quotidienne (APQ) aux établissements médico-sociaux (EMS) accueillant des enfants en situation de handicap.
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2022-088r-rapport_30_min_apq.pdf
Résumé :
Pour faciliter l’appropriation des APQ, le rapport préconise de mettre à disposition des acteurs de terrain des outils facilitateurs (vidéo, fiches…), coconstruits par des experts-praticiens du secteur médico-social et de l’activité physique adaptée (APA).
Pour qualifier durablement les pratiques, les inspectrices recommandent, d’une part de renforcer la présence des professionnels du sport au sein des équipes pluridisciplinaires des établissements, en l’accompagnant financièrement, et, d’autre part d’aborder davantage les APS dans la formation des professionnels éducatifs.
Deux autres conditions pour diversifier les activités sont de poursuivre dans la durée, le développement d’une offre parasports de proximité portée par les fédérations sportives homologues et spécifiques et de consolider certains dispositifs mis en place dans la perspective des Jeu olympiques et paralympiques de 2024.
Enfin le développement des APS au sein des établissements pour adultes, où elles sont moins présentes, mériterait d’être également soutenu pour permettre une continuité de la pratique.
Deux notions
« Parasport » est le terme générique pour désigner l’ensemble des sports pratiqués par les personnes en situation de handicap, en tant que loisir ou en compétition ; il recouvre donc les pratiques de « sport adapté » qui s’adressent aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, et de « handisport » qui concerne les personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur, deux notions utilisées par les fédérations sportives dites spécifiques.
L’« activité physique adaptée » dans son sens large utilisé par le présent rapport recouvre l’ensemble des APS adaptées aux capacités des personnes pour prendre en compte une maladie chronique, un handicap ou une perte d’autonomie liée à l’âge. Elle dispose d’une définition réglementaire à l’article D. 1172-1 du CSP, introduite en lien avec la prescription d’activité physique : « On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. […] . Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences. »